Volcans au bord du réveil : les prévisions des experts sont-elles entendues ?
Dans bien des cas, les volcanologues peuvent déceler les signes précurseurs d'une éruption volcanique. Reste que les meilleures prévisions du monde ne servent à rien si elles ne sont pas entendues par les responsables gouvernementaux, seuls habilités à organiser une évacuation des populations menacées.
Olivier Boulanger - Publié le
Les scientifiques aux aguets

700 000 personnes dans la région du Vésuve, 1,5 million au pied du Merapi en Indonésie, 2 millions d'habitants à proximité du Popocatépeti au Mexique… Encore aujourd'hui, le volcanisme reste une menace pour de nombreuses populations. Fort heureusement, peu d'éruptions volcaniques sont meurtrières. Car, contrairement aux séismes, les éruptions volcaniques sont souvent précédées de signes avant-coureurs. Grâce à la multiplication des stations d'observation et au perfectionnement des instruments de mesures, les volcanologues peuvent ainsi déceler dans bien des cas le réveil d'un volcan et prévoir son éruption quelques heures, voire quelques jours avant qu'elle n'ait lieu. Reste que les meilleures prévisions du monde ne servent à rien si elles ne sont entendues par les responsables gouvernementaux, seuls habilités à organiser une évacuation.
Armero : un cas d’école

« À la question de savoir si les experts sont écoutés, il paraît difficile de répondre tant la communication entre scientifiques et responsables gouvernementaux varient d'un pays à l'autre, explique le volcanologue Jacques Durieux, directeur du Groupe d'observation des volcans actifs. La catastrophe d'Armero, en Colombie, qui a coûté la vie à 25 000 personnes en 1985, est à ce titre dramatiquement exemplaire. » Plusieurs mois avant le désastre, les scientifiques avaient prévu le réveil du volcan Nevado del Ruiz. Ils n'ont pourtant jamais été entendus par les autorités colombiennes. Et le 13 novembre, une gigantesque coulée de boue issue de la fonte des neiges submergeait la vallée et ses habitants.
Pourquoi refuser l’expertise ?
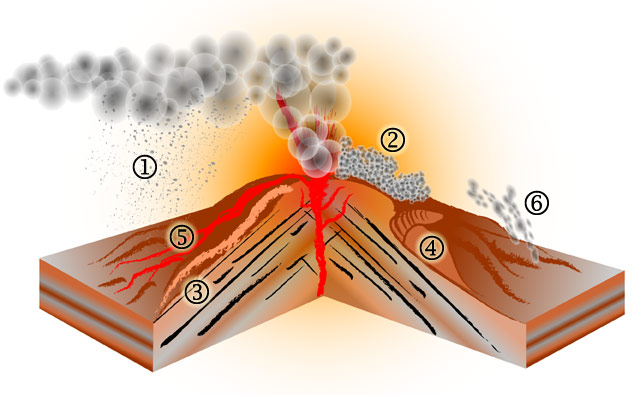
« Dans le cas d'Armero, une part de responsabilité revient sans doute aux scientifiques, tente d'expliquer Jacques Durieux. Nous n'avons pas su transmettre les bons messages, utiliser le bon vocabulaire. Par exemple, on nous riait au nez lorsqu'on parlait de coulées de boue. »
Autre explication : la situation politique particulièrement instable de la Colombie. Il était particulièrement délicat de faire intervenir l'armée, seule à pouvoir organiser une évacuation dans une zone en prise avec la guérilla.
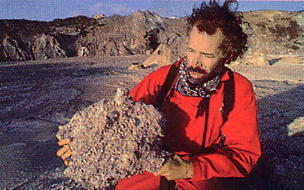 L’éruption du Nyiragongo en janvier dernier était-elle prévisible ? Jacques Durieux, volcanologue. © CSI
L’éruption du Nyiragongo en janvier dernier était-elle prévisible ? Jacques Durieux, volcanologue. © CSI
Mais la dernière raison avancée par Jacques Durieux est beaucoup plus perverse : « Lorsqu’un pays doit évacuer une partie de sa population, il est seul face à ce problème. Il doit décider de l’évacuation, faire accepter cette décision, déplacer ensuite des milliers de personnes, les nourrir, les loger durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. À l’opposé, dès que la catastrophe a lieu, l’aide internationale arrive en masse avec d’énormes moyens financiers, logistiques et matériels. Et très souvent, le pays s’en retrouve plus riche. Avec du recul, on constate que différents États ont fait ce calcul. »
Une action internationale limitée
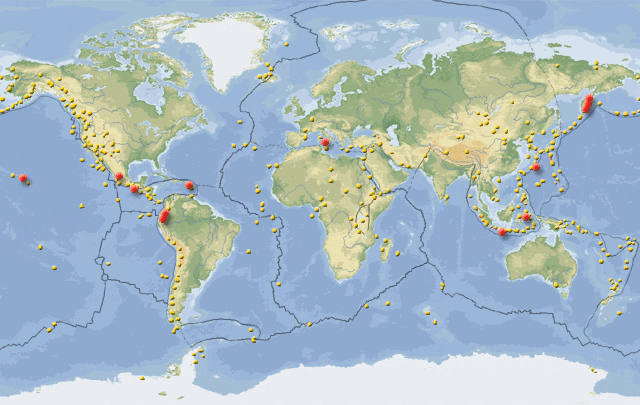
Plusieurs instances internationales peuvent aider les pays confrontés à une crise volcanique. La principale d’entre elles, la World Organization of Volcanic Observatories (Wovo), rassemble les différents observatoires et instituts volcanologiques mondiaux. Bien que son objectif principal soit de stimuler la coopération entre laboratoires, le Wovo apporte son soutien scientifique aux pays qui en font la demande. Son fonctionnement rappelle néanmoins celui d’une ONG : ses experts n’ont pas à se substituer aux volcanologues locaux, et encore moins aux responsables gouvernementaux.
 Quel est le rôle de l’expert dans la gestion de crise ? Jacques Durieux, volcanologue. © CSI
Quel est le rôle de l’expert dans la gestion de crise ? Jacques Durieux, volcanologue. © CSI
Malgré tout, cette collaboration internationale porte ces fruits. Depuis la catastrophe d'Armero, les experts ont revu leur manière de communiquer et de nombreuses catastrophes ont pu être évitées. Lors de l'éruption du Pinatubo en 1991, une entente parfaite entre experts internationaux et responsables gouvernementaux a permis d'organiser l'évacuation de 300 000 personnes. Malgré 500 victimes, 15 000 vies ont ainsi pu être épargnées. Même constat en 1994 où, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la ville de Papaul a pu être évacuée très rapidement. Bilan : aucune victime.
Force est de constater que la gestion des crises volcaniques est de mieux en mieux conduite. « D'autant qu'il faut compter aujourd'hui sur un troisième acteur, avance Jacques Durieux : les médias. Les autorités gouvernementales ont bien compris que s'ils ne réagissent pas aux propositions des experts, ceux-ci seront entendus par les journalistes. Je ne crois pas qu'un gouvernement oserait aujourd'hui prendre le contre-pied de recommandations émises par les scientifiques. »
La France face au risque volcanique

Le territoire français abrite quelques volcans actifs : en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, mais aussi en Auvergne puisque les dernières éruptions ne remontent qu'à 6 000 ans, une fraction de seconde à l'échelle géologique.
La France n'a pas échappé aux problèmes de gestion de crise. En 1976, d'inquiétants signes précurseurs laissent présager que la Soufrière de la Guadeloupe se réveille. Seul problème : le volcan n'est pas équipé de réseau de surveillance et les signaux sont difficilement interprétables. Le conflit qui s'installe entre deux scientifiques (Haroun Tazieff et Claude Allègre) ne fait alors qu'intensifier la crise. Dans ce contexte difficile, le gouvernement prend finalement la décision d'évacuer 70 000 personnes. « En adoptant un principe de précaution, les autorités ont vraisemblablement fait le bon choix, même si les scénarios envisagés étaient très exagérés, note Jean-Christophe Komorowski, ancien directeur de l'observatoire de Guadeloupe. La crise de 76 aura eu au moins un mérite : celui de mettre en évidence le peu de moyens dont disposait la France pour faire face aux éruptions volcaniques. »
Estimez-vous être toujours bien entendu par la préfecture en cas d’alerte volcanique ? Thomas Staudacher... Thomas Staudacher est directeur de l’observatoire volcanologique de La Réunion... © CSI
Depuis cette date, la surveillance s'est organisée. Chaque volcan français est aujourd'hui surveillé depuis un observatoire géré par l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP). Quand une activité anormale est enregistrée, les préfectures concernées et le Comité Supérieur d'Evaluation des Risques Volcaniques (CSERV) sont mis en alerte. Une évacuation peut alors être organisée, basée sur les Plans de secours spécialisé (PSS) qui prévoient l'organisation des transports, de la circulation, de l'accueil et de la protection des réfugiés, de la surveillance contre le pillage… Une organisation parfois jugée lourde si l'on considère qu'elle fait intervenir au moins trois ministères (Recherche, Environnement et Intérieur).


