
Les humains plus violents qu’avant ?
Un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, l’ultramédiatisation de la violence peut conduire à une surévaluation de son importance. C’est la thèse défendue par un nombre grandissant de sociologues.
Enquête de Pierre-Yves Bocquet - Publié le
« Le monde est de plus en plus violent ». Qui n’a jamais pensé (ou entendu dire), devant son journal, sa télévision ou son fil d’actualités, que décidément, la violence est en constante recrudescence ? Conflits armés, actes de terrorisme, faits divers… Le flot continu d’informations en tout genre illustrant la propension de l’être humain à malmener ses congénères semble démontrer chaque jour que les choses vont de mal en pis. Mais ce sentiment n’est-il pas biaisé par le filtre grossissant des médias ? Et à l’heure où nous célébrons le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, n’a-t-on pas tendance à romancer le passé, et à noircir le présent ? C’est la théorie à contre-courant soutenue depuis quelques années par certains sociologues, chiffres à l’appui. Alors, que nous apprennent les statistiques sur la violence, et surtout comment la mesurer et l’objectiver ? L’époque moderne est-elle la plus meurtrière ? La violence réelle et la violence ressentie sont-elles superposables ? Comme le rire, certaines formes de violence sont-elles le propre de l’Homme ? S’agit-il d’un instinct enfoui au tréfonds de son cerveau ? Cette enquête aux multiples entrées apporte des fragments de réponse, en plongeant dans l’histoire et en faisant appel aux sciences humaines pour tenter de cerner les mécanismes de la violence.
Il y a 100 ans, la fin de la Guerre de 14-18
La Première Guerre mondiale marque le début de l’utilisation d’armes d’une puissance inédite issues des technologies permises par l’industrialisation. Les militaires exploitent ainsi les premiers aéronefs, des véhicules blindés (les fameux chars d’assaut) et des sous-marins, qui changent en profondeur les stratégies militaires. Bilan : plus de 18 millions de morts, 400 000 mutilés dont 15 000 « gueules cassées », ces soldats défigurés à la suite de blessures au visage. Des horreurs qui ne sont malheureusement pas l’apanage du passé, ni de l’usage de technologies évoluées : en 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda s’est traduit par 800 000 morts en trois mois avec pour seules armes, des machettes.

Un phénomène à visages multiples
Selon les scientifiques, la violence ne se résume pas à un concept unique. Les origines et les mécanismes sont divers.
L’une des principales difficultés rencontrées par les historiens, les psychologues et les sociologues dans l’étude de la violence est de parvenir à la définir. Préalable indispensable avant d’établir des statistiques et d’en tirer des conclusions... Quand on parle de violence, on pense immédiatement aux guerres, aux actes de terrorisme, aux génocides, aux tueries de masse et homicides. Mais la violence est un phénomène bien plus large et protéiforme. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), elle se définit par « l’utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès ». D’où une typologie tentant d’appréhender le phénomène sous toutes ses formes. On parle ainsi de violence « raciale », « à caractère religieux », « sexuelle », « symbolique » (1), on l’évoque « au travail », « en prison », « à l’école », et on peut même la qualifier de « psychologique »... Cette dernière forme de violence n’est d’ailleurs reconnue dans le droit français que depuis la loi de 2010, votée dans le cadre de la répression des violences faites aux femmes. Une illustration parfaite du fait que la violence ne se limite pas aux homicides, et qu’elle évolue non seulement en ampleur, mais en nature, en changeant de forme selon les époques.
(1) Théorisée par le sociologue Pierre Bourdieu et l’épistémologue Jean-Claude Passeron, la violence symbolique se fonde sur un mécanisme de domination sociale : une partie de la population, socialement et culturellement défavorisée, est dominée et développe un sentiment d’infériorité face aux intellectuels aisés.
La fin des armes chimiques ?
Les Première et Seconde Guerres mondiales sont marquées par les atrocités de l’utilisation massive de gaz moutarde et l’extermination de plus de trois millions de Juifs, homosexuels et Tziganes dans les chambres à gaz. En 1997, entre en vigueur la Convention sur l’interdiction des armes chimiques. Complétant la Convention de Genève de 1925, ce traité international, signé par la plupart des pays du monde, stipule que la fabrication et la possession d’armes chimiques sont interdites. Ce type d’armes continue pourtant d’être utilisé, comme en Syrie où de fortes présomptions d’attaques au gaz sarin ont été dénoncées près de Damas en août 2013 (1 300 morts) et à Khan Cheikhoun (plus de 80 morts) en avril 2017.

Le grand tournant de la fin du Moyen Âge
Depuis la fin du XVe siècle, les actes de violence sont en diminution constante dans les pays occidentaux, sous l’effet du renforcement de l’arsenal législatif.
Vous rêvez de l’époque épique des chevaliers, des châteaux forts et des tournois ? Félicitez-vous plutôt de n’avoir pas vécu à cette période où violence et torture faisaient partie du quotidien. Les scientifiques s’accordent en effet à penser, dans la lignée du sociologue allemand Norbert Elias et de l’historien français Robert Muchembled, que la violence a fortement baissé en Europe et dans les pays développés depuis la fin du Moyen Âge (vers le XVe siècle). La raison : l’essor, à partir du XVIe siècle, de sociétés de plus en plus portées sur la civilité et le bannissement des crimes. L’interdiction des duels décrétée sous Louis XIII par le Cardinal de Richelieu en 1626 symbolise ainsi la pacification des mœurs à Versailles et dans les autres cours européennes. Cette criminalisation progressive des actes violents, accentuée au XVIIIe siècle par les mouvements de pensée des Lumières – qui accordent à la vie une valeur de plus en plus importante –, va aboutir à une baisse sensible de la criminalité. Selon les chiffres qui font consensus chez les historiens et les sociologues, le nombre d’homicides dans le monde est ainsi passé, pour 100 000 habitants, d’environ 100 par an au XIIIe siècle à 10 au XVIIe et à moins de 1 de nos jours. Cette moyenne cache évidemment des disparités : de nombreux pays d’Amérique du Sud (Honduras, Salvador, Venezuela…) ou d’Afrique (Zambie, Ouganda, Lesotho…) affichent encore des taux très élevés d’homicides, supérieurs à 20 par an pour 100 000 habitants.
Quand la violence inspire l’art
Nombreux sont les artistes inspirés par le thème de la violence, d’Eugène Delacroix en 1830 avec La Liberté guidant le peuple (en référence aux barricades de la Révolution française) au groupe de rock U2 et son célèbre Bloody Sunday (dénonciation du massacre de militants pacifistes par l’armée britannique en 1972). Mais l’une des œuvres d’art les plus emblématiques reste Guernica de Pablo Picasso. L’artiste y dépeint le bombardement de la ville espagnole de Guernica, survenu le 26 avril 1937, pendant la guerre d’Espagne opposant républicains et nationalistes. Ce bombardement aérien, ordonné par les nationalistes et exécuté par les troupes allemandes et italiennes, fit près de 130 victimes civiles.

Une violence en baisse mais plus visible
Conséquence de notre société de l’information, la médiatisation de la violence est permanente et peut conduire à une surévaluation de son importance.
Si la violence est en baisse, pourquoi a-t-on le sentiment contraire ? Ce paradoxe s’explique par la conjugaison de plusieurs phénomènes. Premièrement, à l’heure de l’information en continu et des réseaux sociaux, la connaissance des actes violents n’a jamais été aussi forte : journaux et fils d’actualités nous abreuvent en permanence d’actes de violence perpétrés tout autour du monde, pouvant conduire à un sentiment de peur diffuse et de sinistrose. En France, selon le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), nous sommes confrontés à deux meurtres et à une dizaine d’actes violents par heure, y compris à travers les fictions. Soit, pour un téléspectateur « moyen » qui regarde la télévision 3 heures 30 par jour, un total de près de 2 600 meurtres et 13 000 actes violents par an ! Même si ces actes sont au final loin d’être la norme, ils sont vus par le biais d’un filtre grossissant qui renforce artificiellement leur importance. Or, l’exposition à la violence semble favoriser les actes violents. Ce cercle vicieux, bien connu des psychologues et des sociologues, a une nouvelle fois été rappelé par des chercheurs américains dans une méta-analyse publiée en juin 2018 dans le Journal of Social Issues. Basée sur des dizaines d’études publiées depuis quinze ans sur le sujet, cette synthèse conclut que des liens sont scientifiquement établis entre l’exposition à la violence sur les écrans (télévision, cinéma, jeux vidéo...) et la survenue d’un état d’esprit agressif, d’une désensibilisation à la violence et d’un déficit d’empathie.
Quand les écrans font écran...
Smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs... Les écrans n’ont jamais été aussi nombreux pour satisfaire notre appétit d’images. Nous voilà ultra-connectés et réseaux-socialisés, comme pour mieux nous indigner de la violence du monde. Pour autant, des experts nous mettent en garde : la médiatisation de la violence traduit mal la réalité de la violence. Ainsi, les rares images des naufrages de migrants ne rendent pas compte de toutes les tragédies en cours, pouvant même, pour certains, contribuer à leur banalisation, voire à un certain fatalisme. L’auteur du monumental film de 9 heures consacré à la Shoah, Claude Lanzman, mort en 2018, affirmait avec force que montrer l’horreur (images d’archives ou films de fiction) ne permet pas de (se) la représenter.

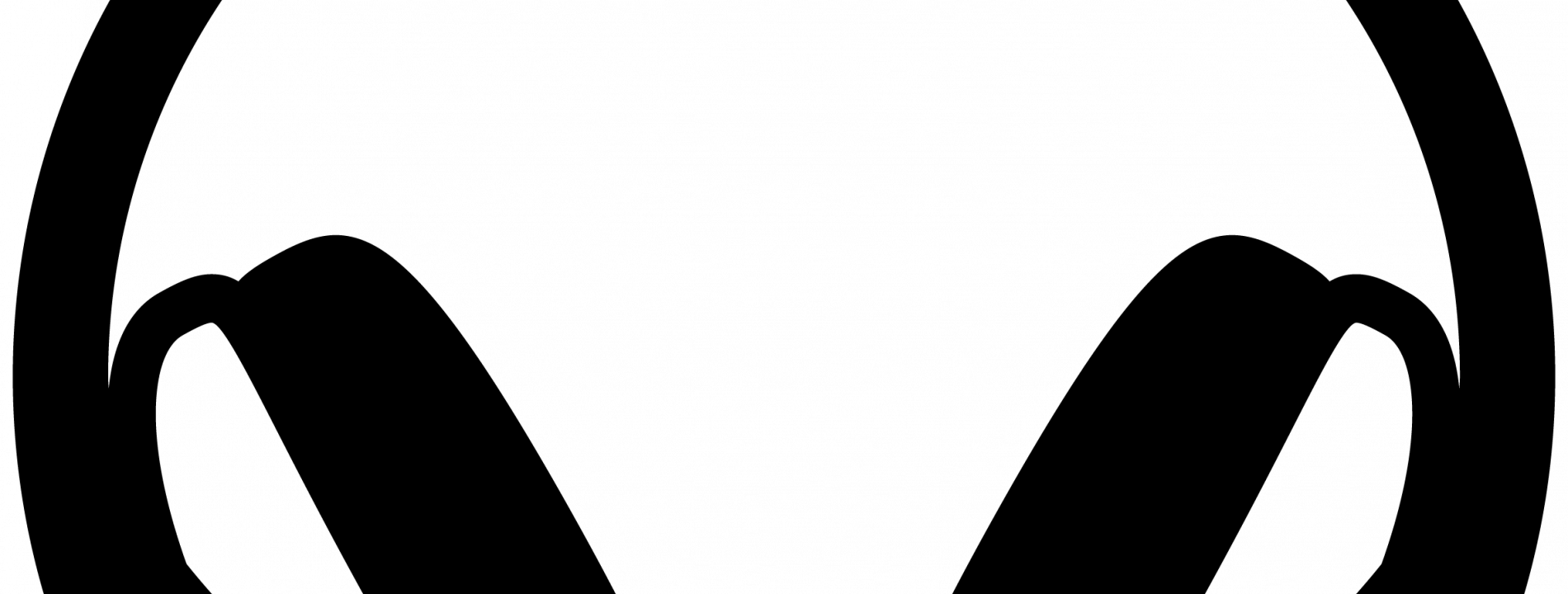
Les jeux vidéo à l’origine de comportements violents ?
Laurent Bègue, professeur de psychologie sociale à l’université Grenoble Alpes, détaille les principales méthodes utilisées pour évaluer ce lien.
Une biologie de la violence ?
Tous nos comportements sont liés à des processus cérébraux. Mais les racines de la violence ne peuvent se résumer à des dysfonctionnements neuronaux.
Grâce aux progrès de la neuro-imagerie, on a pu identifier dans le cerveau des circuits neuronaux impliqués dans les émotions, comme le circuit de la colère, de l’agression, du contrôle de soi, ou de la peur. Les travaux de certains neuroscientifiques, comme Adrian Raine, ont même suggéré un lien entre des dysfonctionnements cérébraux (au niveau du cortex préfrontal et de l’amygdale) et des comportements violents. Ces thèses, souvent basées sur l’étude des cerveaux des criminels, sont toutefois contestées par une partie de la communauté scientifique. Des neuropsychologues estiment en effet que de nombreux facteurs environnementaux – comme l’origine sociale, la pauvreté, la surpopulation, la consommation d’alcool et d’autres drogues, les relations familiales, l’insertion sociale – influent de façon non négligeable sur le passage à l’acte criminel. Plusieurs études récentes ont même mis en évidence des corrélations inattendues. La consommation d’oméga 3, un acide gras essentiel au bon fonctionnement des neurones, aurait ainsi un impact sensible sur le mécanisme d’action de la sérotonine, une hormone impliquée dans les comportements impulsifs et agressifs. Une étude publiée fin 2017 dans la revue Psychiatry Research par des chercheurs des universités de Grenoble et de Davis (Californie) a ainsi mis en évidence qu’une supplémentation en oméga 3 pendant 6 semaines chez près de 200 adultes réduirait le nombre de comportements agressifs d’environ 30 %. Des résultats fragiles à considérer avec circonspection, car basés sur des déclarations et non sur des situations réelles.
Les scientifiques face au terrorisme
À la suite des attentats du 13 novembre 2015 (137 morts) à Paris, une équipe de scientifiques pilotée par l’historien Denis Peschanski (CNRS) et le neuropsychologue Francis Eustache (Inserm) a lancé une vaste étude sur la mémoire auprès de 1 000 volontaires, victimes directes ou indirectes des attentats. Menés sur douze ans, ces travaux ont pour objectif principal de mieux comprendre l’articulation entre mémoire individuelle et collective. Une démarche s’inspirant du programme 911 – Memory conduit par le psychologue américain William Hirst suite aux attentats du 11 septembre 2001 à New-York (2996 morts). Une analyse comparée des résultats de ces deux études est d’ores et déjà prévue.

Un héritage de l’évolution ?
La capacité de l’Homme à tuer ses congénères n’est pas unique dans le règne animal. Elle semble être un produit de l’évolution.
Cela fait des siècles que deux visions s’opposent sur la propension de l’Homme à commettre des actes de violence. Pour l’une, l’être humain serait bon par nature et serait ensuite perverti par son environnement social. Pour l’autre, il serait un animal comme les autres, écoutant son instinct pour satisfaire ses besoins ou envies les plus primaires, l’éducation le détournant de ce penchant naturel. Une étude a peut-être en partie tranché la question. Les chercheurs de trois universités espagnoles ont en effet publié en septembre 2016 dans la revue Nature une étude comparant les meurtres au sein d’une même espèce commis chez différents mammifères, incluant l’humain, en fonction de leur position dans l’arbre de l’évolution. En étudiant 3 500 articles sur les mammifères – dont près de 1 000 articles sur les causes de la mortalité parmi les humains – elle a mis en évidence que 40 % des 1 024 espèces de mammifères étudiées ont tendance à s’entretuer. Et que cela s’observe aussi chez des animaux apparemment pacifiques et non carnivores, tels que les chevaux, les marmottes ou les rhinocéros. La propension à tuer ses congénères ne serait donc pas propre à l’espèce humaine, mais au contraire généralisée dans le règne animal. Celle observée chez l’Homme est d’ailleurs assez proche de celle des grands singes, nos proches cousins, même si elle ne prend pas forcément la même forme. Les primates sont notamment coutumiers des infanticides, qui s’accompagnent parfois de cannibalisme, comme des chercheurs japonais l’ont rapporté en octobre 2017 dans l’American Journal of Physical Anthropology après avoir observé un mâle chimpanzé dévorer un nouveau-né.
Les violences sexuelles en hausse ?
En France, les femmes sont trois fois plus souvent victimes de violence sexuelle que les hommes. La dernière étude sur l’évolution de la délinquance montre une progression de ce type de violence de 23 % en 2018 par rapport à 2017. Une augmentation qui s’explique notamment par le fait que de plus en plus de femmes osent porter plainte, et ce depuis l’émergence du mouvement #MeToo suite à l’affaire Weinstein qui a secoué le monde du cinéma en octobre 2017 et aux nombreux témoignages de viols et de harcèlement sexuel d’actrices.
La responsabilité des armes à feu
La répétition des tueries de masse aux États-Unis (où la liberté de posséder une arme est inscrite dans la Constitution) peut donner l’impression que la violence y est en hausse. Or, sur l’ensemble du pays, la criminalité a diminué de moitié depuis les années 1990. Ce qui n’a pas empêché Donald Trump de déplorer, en février 2017, que les homicides aient atteint leur plus haut niveau depuis 47 ans. Il reste néanmoins vrai que la moitié des décès par armes à feu dans le monde sont concentrés aux États-Unis et dans cinq autres pays : Brésil, Mexique, Colombie, Venezuela et Guatemala. Le plus touché étant le Brésil, totalisant à lui seul un quart des victimes mondiales par armes à feu.



