
Techno : vers la sobriété numérique ?
Nos sociétés ultraconnectées ne peuvent plus se passer du numérique. Avec des impacts sur l’environnement et la santé qui appellent à modérer nos usages.
Textes de Pierre-Yves Bocquet - Publié le
Le monde est entré depuis une quinzaine d’années dans l’ère de l’ultraconnexion. Le nombre de smartphones est en hausse constante et nos foyers accueillent de plus en plus d’objets communicants. Dans le même temps, grâce aux progrès des télécommunications (fibre, 5G...), nous disposons de débits sans fil de plus en plus importants. Résultat : le trafic explose, tiré par des activités toujours plus gourmandes en bande passante (stockage et partage de données, vidéos en ligne...). Cette activité numérique, immatérielle, est souvent considérée comme propre. Or, la fabrication et le fonctionnement de l’écosystème numérique (réseaux, data centers...) nécessitent d’importantes dépenses énergétiques et génèrent des impacts non négligeables sur l’environnement, à commencer par des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles de l’aviation. D’où l’appel de certains experts à faire entrer d’urgence la société dans une nouvelle ère, celle de la sobriété numérique, en reconsidérant nos usages numériques à l’aune de leur impact, exactement comme on le ferait pour la voiture ou l’avion. Un nouveau paradigme, voire une petite révolution, dans un monde dopé de toutes parts aux technologies numériques. Avec in fine une remise en cause profonde de nos modes de vie et comportements, guidés de façon addictive par l’omniprésence des écrans.

La face cachée du numérique
Invisibles, les data centers – au nombre de 4 424, situés dans 122 pays – forment la colonne vertébrale des activités numériques mondiales. C’est vers eux que transitent toutes nos données (mails, messages, photos, documents…) pour y être stockées dans le fameux cloud. Ces bâtiments remplis de serveurs électroniques, opérationnels 7 j/7 et 24 h/24, peuvent consommer jusqu’à 100 millions de watts (100 MW), soit 10 % de la production électrique d’une centrale thermique. La moitié de cette consommation étant destinée au refroidissement des disques durs, les opérateurs déploient des trésors d’ingéniosité pour bénéficier d’une climatisation naturelle, en les installant dans des pays froids (comme Facebook en Suède) ou sous l’eau, comme Microsoft qui a immergé un centre expérimental dans les eaux froides de l’Écosse (photo), en juin 2018.
Une prise de conscience récente
L’urgence climatique ignore trop souvent l’impact environnemental des activités numériques.
Depuis les années 1980, la communauté internationale s’est officiellement engagée à lutter contre le réchauffement climatique lié aux activités humaines (industrie, transport, chauffage...). Une prise de conscience concrétisée par la création du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) en 1988, et la signature d’accords (Rio en 1992, Kyoto en 1997, Johannesburg en 2002, Paris en 2015) visant à limiter les émissions des gaz à effet de serre des pays signataires. Une des pistes envisagées est la transition d’industries lourdes consommatrices d’énergies fossiles (sidérurgie, chimie, automobile…) vers les activités numériques considérées comme sources de productivité, d’efficacité et d’emplois « propres ». Or, une autre prise de conscience émerge depuis quelques années : le numérique – ordinateurs, smartphones, réseaux sans fil, services en ligne, réseaux sociaux, objets connectés, intelligence artificielle –, dont la vitesse de propagation est fulgurante, devient lui-même énergivore. L’Agence pour la maîtrise de l’énergie (Ademe) estime ainsi qu’à poids équivalent, produire un smartphone consomme près de 80 fois plus d’énergie que fabriquer une voiture à essence. Autre exemple : selon une étude américaine parue en juin 2019, l’entraînement d’un réseau de neurones pendant 96 heures à des fins d’intelligence artificielle – comme les assistants vocaux (Alexa, Siri, Google Assistant) – émet autant de dioxyde de carbone qu’une traversée des États-Unis en avion. Le secteur du numérique soulève à son tour des problèmes de production et de consommation énergétiques. Avec leur corollaire : plus d’émissions de gaz à effet de serre.
La folie de l’hyperconnexion
Si certains objets ont tout intérêt à disposer d’un accès à Internet, comme les enceintes connectées (pour le fonctionnement des assistants vocaux), les caméras de surveillance (pour nous prévenir en cas d’intrusion) ou les thermostats (pour réguler la température à distance), cet usage touche aussi des objets pour lesquels cela semble moins pertinent : frigo, lave-vaisselle, ceinture, cravate, tétine… À ce rythme, tous les objets, ou presque, existeront bientôt en version connectée. Formant un immense « Internet des objets » qui devrait générer plus de 25 milliards de connexions dans le monde en 2025, selon les estimations de GSMA Intelligence, contre 6,3 milliards en 2016.

De réels impacts sur l’environnement
De la production des objets high-tech à leur fin de vie, l’empreinte environnementale du secteur du numérique est loin d’être négligeable.
L’impact des objets high-tech (smartphones, ordinateurs, appareils connectés) sur l’environnement commence dès leur fabrication. Il faut bien sûr extraire les métaux qui entrent dans leur composition (batteries, écrans, circuits électroniques), une des activités industrielles les plus polluantes. En outre, les métaux sont parfois des ressources menacées de pénurie ou dont l’approvisionnement pose des problèmes de dépendance économique, comme le lithium pour les batteries, ou des terres rares (gallium, indium, tantale, ruthénium, germanium…), souvent utilisées dans les écrans en raison de leurs propriétés optiques spécifiques. Il faut aussi prendre en compte la consommation énergétique (et donc la pollution) liée à leur usage, et à celui de l’infrastructure (réseau, data centers…) dans laquelle transitent et sont stockées les données. Selon l’université de Louvain, la consommation électrique annuelle du numérique s’élève à 1 500 TWh, soit 10 % de la production mondiale d’électricité. Ce secteur serait ainsi responsable de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon le cabinet spécialisé Gartner, soit un impact sur le climat comparable à celui de l’aviation. Enfin, lorsqu’ils arrivent en fin de vie, les objets high-tech forment des tonnes de déchets, ce qui augmente encore l’empreinte environnementale du numérique. En janvier 2019, l’Onu a lancé une campagne de sensibilisation sur les déchets électroniques : ils représentent 50 millions de tonnes chaque année dans le monde, dont seulement 20 % recyclés.

Une pollution globale mais aussi locale
La quasi-totalité des réserves exploitées de terres rares (éléments chimiques très prisés en électronique pour leurs propriétés optiques) se situent en Chine, où leur extraction et leur traitement causent d’importants dommages environnementaux – les techniques d’extraction reposant sur l’utilisation d’acide sulfurique, utilisé pour dissoudre le minerai. Par ailleurs, les gisements de terres rares contiennent souvent des composés radioactifs (uranium et thorium). Le tout est donc libéré dans de grands lacs artificiels, qui polluent les sols et les nappes phréatiques, comme autour de la mine chinoise de Bayan Obo, l’une des plus grandes du monde.
Un recyclage encore balbutiant
En Europe et dans les autres pays industrialisés, des normes imposent que les déchets électroniques soient collectés et retraités. Mais en pratique, cette opération est peu rentable, car ordinateurs, tablettes et autres smartphones recèlent pas moins de soixante éléments chimiques différents, en faibles quantités. Grappiller quelques milligrammes de métal rare dans un circuit électronique reste donc une opération complexe, dont les gains peinent à couvrir les coûts. Ces déchets embarrassants sont donc parfois exportés illégalement vers des pays à bas coûts. Comme ici au Ghana : la décharge monumentale d’Agbogbloshie est l’une des plus grandes au monde, et parmi les plus polluées.

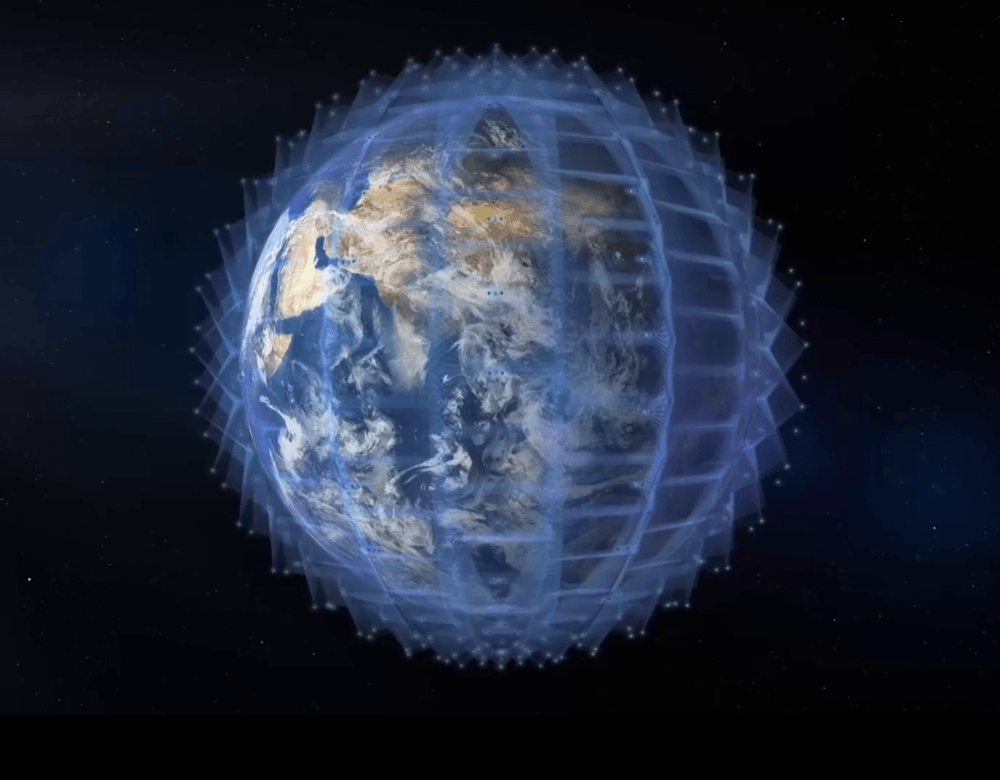
Des disparités géographiques
La surconsommation numérique ne touche pas toutes les régions du monde de la même façon. En 2021, le nombre moyen d’équipements connectés par individu s’élèvera à 13 pour un Américain, 9 pour un Européen, 3 pour un Asiatique, et 1,4 pour un Africain, selon l’entreprise américaine Cisco. Mais la principale fracture reste Internet, auquel seulement 40 % de la population mondiale (3,2 milliards de personnes) a aujourd’hui accès, selon la Banque mondiale. Une proportion vouée à augmenter dans les années à venir, avec le lancement de mégaconstellations de satellites destinés à assurer l’accès à Internet aux régions les plus isolées. Comme celles de OneWeb (photo) ou de Starlink, dont les premiers satellites ont été lancés en février et en mai 2019.
Des abus néfastes pour la santé
L’hyperconnexion peut conduire à des problèmes d’addiction et perturber les rythmes biologiques.
Outre les raisons environnementales, la conversion vers la sobriété numérique semble s’imposer pour limiter les impacts des nouvelles technologies sur la santé. Premier enjeu : les problèmes d’addiction (Internet, smartphone, selfies, messageries, réseaux sociaux, jeux vidéo…), qui occupent une place croissante dans nos sociétés. En France, un internaute passe en moyenne 80 minutes par jour sur les réseaux sociaux, dont l’abus peut s’accompagner de syndromes d’anxiété et de dépression, comme l’ont déjà démontré plusieurs études, dont celle de l’université de Pennsylvanie aux États-Unis, parue fin 2018 dans le Journal of Social and Clinical Psychology. Une autre étude parue en décembre 2018 dans New Media and Society sur de gros utilisateurs de smartphone montre même que la relation qu’ils développent avec leur appareil relève… de la camaraderie ! C’est-à-dire qu’elle suscite des émotions (joie, stress, manque…) proches de celles qui caractérisent en général des relations humaines. Autre impact : les troubles liés à la lumière émise par les écrans. Dans un rapport publié en avril 2019, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) souligne que « les écrans d’ordinateurs, de smartphones et de tablettes constituent des sources importantes de lumière riche en bleu » et « qu’une exposition, même très faible, à de la lumière riche en bleu, le soir ou la nuit, perturbe les rythmes biologiques et donc le sommeil ». En particulier chez les enfants et les adolescents, dont les yeux ne filtrent pas pleinement la lumière bleue, et qui « constituent une population particulièrement sensible ».
Le « streaming » fait exploser le trafic
Le trafic, c’est-à-dire la quantité de données qui transitent dans les réseaux Internet à chaque instant, progresse d’environ 25 % par an. Il est boosté à la fois par la hausse du nombre de terminaux (smartphones, tablettes, ordinateurs…) qui se connectent au réseau, mais aussi par l’essor sans précédent des vidéos à la demande (streaming), qui permettent de visionner des vidéos en ligne, comme sur Netflix, Youtube ou les offres de télé en « replay ». Le visionnage de vidéo accaparait à lui seul la moitié du trafic en 2016, et en monopolisera les deux tiers en 2021, selon l’entreprise Cisco. Les besoins sont d’autant plus importants que ces services montent en qualité et proposent des vidéos en haute définition… forcément plus gourmandes en bande passante.

Un éventail de solutions durables
Il n’existe pas de solution miracle, mais une panoplie de dispositifs, à déployer chez les industriels et les particuliers.
Pour rendre le numérique plus durable, les ingénieurs planchent sur de nouveaux composants électroniques et des protocoles de communication haut débit intrinsèquement plus sobres en énergie, comme le Bluetooth Low Energy ou le LoRa, pour abaisser la consommation électrique des appareils communicants. Et ce même quand ils ne fonctionnent pas, en améliorant leur réactivité afin qu’ils puissent se mettre en veille plus souvent et se rallumer rapidement. Autre approche plus radicale : une vraie sobriété numérique, c’est-à-dire le passage d’une consommation intensive à un usage plus modéré. Avec, du même coup, une sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques : acheter un équipement dont la puissance correspond à l’utilisation réelle, faire durer son smartphone ou son ordinateur plus longtemps avant de le remplacer, éviter les usages superflus consistant à laisser allumé un appareil non utilisé, ne pas envoyer un mail quand un moyen de communication plus sobre est possible (téléphone, SMS ou... discussion de vive voix !), ne pas envoyer de pièce jointe trop volumineuse, nettoyer sa boîte mail des messages et newsletters inutiles... Autant de petits gestes apparemment anodins qui, mis bout à bout, permettront d’alléger l’appétit des ogres énergétiques que sont les data centers.

Après l’« intox », la « détox » ?
Chacun a ressenti une fois au moins les effets toxiques de l’hyperconnexion : déconcentré par l’afflux d’informations, hypnotisé par le puits sans fond des posts et des vidéos sur les réseaux sociaux, sans oublier la connexion potentiellement permanente avec le stress de l’univers professionnel. Poussant d’ailleurs certains psychologues et sociologues à prôner la digital detox, une forme de sobriété numérique pour se protéger de l’hyperconnexion et retrouver son « moi » réel, et pas seulement son avatar, l’image censée nous représenter sur les réseaux. Une tendance qui interroge nos modes de vie : certes, il est possible de rester connecté en permanence, où que l’on soit, et à toute heure du jour et de la nuit. Mais faut-il pour autant y céder ?
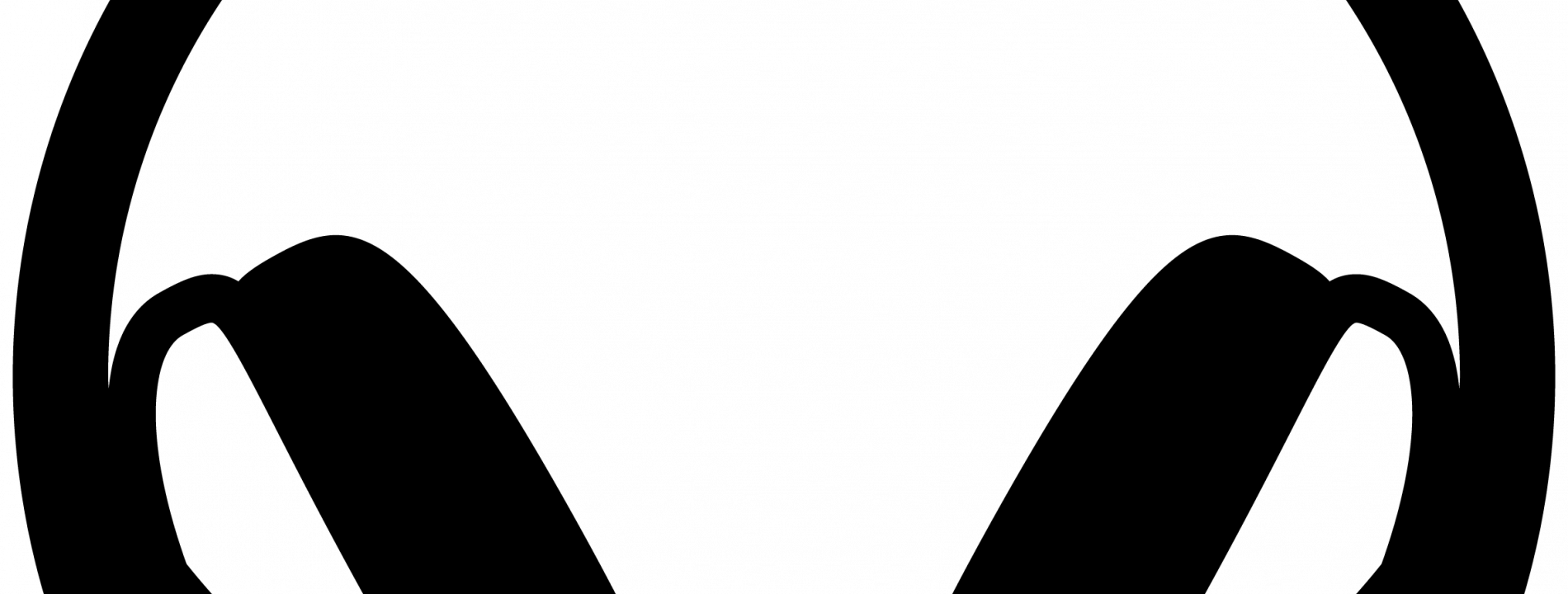
Le bilan écologique du numérique
Pour Françoise Berthoud, ingénieure de recherche en informatique au Gricad(CNRS), les activités numériques peuvent aussi avoir des impacts environnementaux indirects.


