
L’antiterrorisme au prisme des sciences sociales
Pour répondre au terrorisme, les autorités françaises ont déployé un vaste éventail de mesures. Un sujet d’intérêt pour les politistes, les juristes et les sociologues.
Natacha Scheidhauer - Publié le
Après les attentats, l’antiterrorisme s’organise
Pose de bombes, fusillades… les attentats du 13 novembre 2015 s’inscrivent dans une longue série d’attaques de masse perpétrées depuis 2001, notamment en Europe et aux États-Unis, revendiquées par les organisations terroristes islamistes comme Al-Qaida ou Daech.
En France, pays européen le plus touché entre 2001 et 2024 avec 302 morts, c’est à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) qu’est confié le pilotage opérationnel de la lutte antiterroriste : identifier les réseaux et les individus « susceptibles de mener une action violente », évaluer les risques liés à la présence « de combattants djihadistes », analyser « des phénomènes de radicalisation violente ». Une mission conduite en collaboration avec les autres services de renseignement, sous l’égide d’une coordination nationale créée en 2017. Pour mener cette lutte, les autorités mobilisent des outils technologiques et juridiques, comme l’état d’urgence, dispositif exceptionnel créé en 1955 et renforcé après 2015, qui confère des pouvoirs accrus aux forces de l’ordre.
Ces initiatives ont amélioré la prévention des actes terroristes – 82 attentats déjoués depuis 2015 selon la DGSI – mais soulèvent bien des interrogations. Les sciences sociales étudient ainsi leur impact sur la société, mais aussi sur les libertés publiques et la cohésion sociale. Ce regard critique nourrit la quête d’équilibre entre sécurité collective et respect des droits fondamentaux, condition indispensable à une lutte durable contre le terrorisme.

Le retour de l’état d’urgence
Le 13 novembre 2015 à 23h55, François Hollande annonce l’instauration de l’état d’urgence. Le contrôle aux frontières est rétabli et celui des passagers intensifié dans les gares et aéroports. Des décisions d’ordinaire validées en amont par les autorités judiciaires sont transférées aux autorités administratives : le ministère de l’intérieur et les préfets peuvent instaurer des couvre-feux, interdire des réunions publiques, fermer des lieux de culte, mener des perquisitions, assigner à résidence toute personne dont l’activité serait dangereuse pour l’ordre public ou bloquer des sites web ou réseaux sociaux faisant l’apologie du terrorisme. L’état d’urgence restera en vigueur jusqu’au 1er novembre 2017.
Un arsenal législatif : vers la prévention des actes
Confrontée aux attentats depuis les années 1970, la France s’est dotée d’une abondante législation en matière d’antiterrorisme. Avec deux particularités. Tout d’abord, elle réserve l’instruction des affaires à des magistrats spécialisés, puis les fait juger par une cour d’assises où le jury populaire habituel est remplacé par des professionnels. Ensuite, elle sanctionne les actions terroristes même à l’état de projet, grâce à une mesure phare : l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (AMT) instaurée en 1996, qui s’accompagne de règles de procédures assouplies comme la garde à vue étendue à 6 jours (48 heures en droit commun) ou l’anonymat des enquêteurs.
Entre 2015 et 2024, treize lois sont ainsi promulguées, dont celle dite de Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (SILT) de 2017, qui intègre dans le droit commun des dispositions jusque-là réservées à l’état d’urgence. Avec ce nouvel arsenal législatif, les juges ne se contentent plus d’établir les faits passés, mais doivent évaluer la dangerosité potentielle des accusés : « Centré sur la police, les services de renseignement, l’administration et les prisons (…), il témoigne de la consécration du “virage préventif” », commentent les chercheurs A. Mégie, S. Weill et E.-P. Guittet dans un article de 2021. Au prix d’un risque souvent pointé du doigt, celui d’un glissement de la présomption d’innocence vers la présomption de culpabilité.
Cela étant, dans les faits, le verdict du procès des attentats du 13 novembre a été salué comme plutôt équilibré, avec des peines proportionnées au rôle de chaque accusé dans ces événements.
La vidéosurveillance, utile... rétrospectivement
La vidéosurveillance permet de retracer le parcours des terroristes et facilite le travail d’enquête. En revanche, elle échoue à prévenir les actes, même dans sa version augmentée à l’IA : « Il faudrait d’abord savoir qui ou quoi rechercher », explique Guillaume Gormand, chercheur en administration publique (Grenoble-Alpes métropole). Or ceux qui se radicalisent dans le huis clos de leur chambre sont souvent de parfaits inconnus. En 2016, l’enregistrement par la vidéosurveillance des repérages effectués par le conducteur du camion, la veille de l’attentat de Nice, n’a pas permis d’empêcher son acte.


Tarir les financements
Assécher ses ressources financières est un axe fort de la lutte antiterroriste. Depuis 2015, Tracfin, le service de renseignement rattaché au ministère des finances, surveille ainsi les transferts de capitaux suspects. Les enquêtes menées par les institutions de lutte contre le trafic de biens culturels montrent par ailleurs que la revente des « antiquités de sang », ces objets patrimoniaux pillés par les groupes terroristes, est une source majeure de financement, avec le trafic d’armes et de drogue. Des recherches sont ainsi menées pour améliorer la traçabilité des antiquités, comme un marquage à base d’encre contenant des marqueurs nanométriques.
En ligne, une surveillance multiforme
En 2024, près de 25 000 personnes faisaient l’objet d’une surveillance en France, dont 30 % au titre de la prévention du terrorisme. Un chiffre en recul de 17 % depuis 2020, d’après la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) créée en 2015. En complément du renseignement humain, les services mettent en oeuvre toutes les technologies disponibles pour collecter des données permettant de détecter et d’identifier les menaces.
Ils récoltent ainsi des informations en sources ouvertes (d’information publique), en « cyberpatrouillant » sur les réseaux sociaux ou sur internet. Ils utilisent aussi les moyens prévus dans le cadre des enquêtes judiciaires – géolocalisation, captation d’images, sonorisation, accès à distance à des supports informatiques comme des clés USB ou des disques durs – habituellement réservés au traitement des infractions déjà commises. Dans le cadre de cette lutte préventive, les services disposent par ailleurs de moyens propres, notamment depuis la loi Renseignement votée après l’attentat contre l’hebdomadaire Charlie Hebdo, en janvier 2015. Comme l’IMSI-catcher ou intercepteur d’IMSI (International Mobile Subscriber Identity), une valisette qui simule une antenne relais intermédiaire entre l’opérateur téléphonique et le téléphone surveillé. Ou les filtres algorithmiques installés sur les réseaux électroniques des opérateurs de télécommunications – des techniques qui peuvent révéler jusqu’au contenu des échanges.
Les services recourent enfin à l’intelligence artificielle pour détecter des comptes diffusant des termes ou des images suspects, mais il est trop tôt pour dresser un bilan de l’efficacité de ces derniers outils.
Les réseaux sociaux en ligne de mire
Peu avant les Jeux olympiques de Paris, un mineur originaire de Haute-Savoie a été placé sous contrôle judiciaire : il affirmait sur le réseau social Telegram vouloir mourir en martyr en déclenchant une ceinture d’explosifs. Depuis 2015, les réseaux sociaux constituent de fait une priorité de l’antiterrorisme. Des cyberpatrouilleurs y repèrent en particulier « ces terroristes inspirés par la propagande, sans commanditaire ni lien opérationnel direct avec une organisation », explique Marc Hecker, directeur exécutif de l’Institut français des relations internationales (Ifri). La surveillance des réseaux permet aussi d’identifier les nouvelles recrues des réseaux constitués.

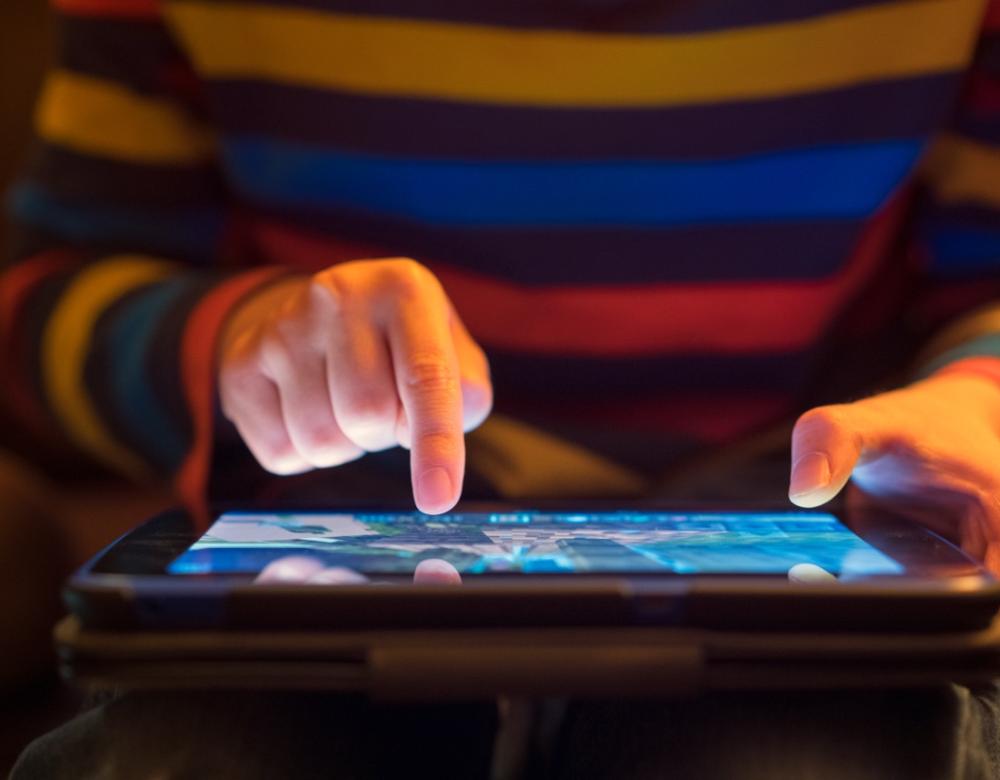
Des algorithmes plus ciblés
Initialement prévue pour analyser automatiquement les métadonnées de certaines communications (numéro appelé, type de connexion, géolocalisation, horodatage), la surveillance algorithmique inclut désormais les adresses IP des internautes (le numéro d’identification de l’appareil connecté au réseau) et dans certains cas, l’URL complète des pages consultées. Il devient ainsi possible d’identifier des comportements en ligne précis, comme la consultation répétée de contenus jugés sensibles (vidéos de propagande djihadiste…). Pour ce faire, les algorithmes analysent en continu un large volume de données. L’efficacité de ce dispositif reste difficile à évaluer, faute d’analyses rendues publiques.
Libertés publiques, matière sensible
Prises dans un moment de sidération, d’anxiété ou de colère, les mesures exceptionnelles accordées à l’antiterrorisme sont généralement plébiscitées par le public. Or il s’agit d’outils à manier avec précaution, car ils restreignent de fait les libertés individuelles, comme la liberté de se réunir ou de manifester. Juristes, sociologues, spécialistes de la fonction publique, défenseurs des droits… s’accordent ainsi sur le fait que l’arsenal de l’antiterrorisme devrait d’abord s’appuyer sur le droit commun et n’en sortir qu’en tenant compte de l’équilibre entre protection des populations et respect des libertés individuelles.
Une mission dévolue aux contre-pouvoirs institutionnels, mais aussi à la mobilisation citoyenne. Charge au corps social de résister à « l’habituation » décrite en 2024 par les universitaires américains Cass Sunstein et Tali Sharot : en s’appuyant sur les neurosciences et les sciences comportementales, ils décrivent un processus anesthésiant d’accoutumance et appellent à « réapprendre à voir » pour en combattre les travers.
Le sociologue Laurent Bonelli (université Paris-Nanterre) signale également que l’application de certaines dispositions antiterroristes fait peser un risque sur la cohésion sociale : « Employées sans discernement, des mesures administratives (…) comme la fermeture de lieux de culte pourraient stigmatiser des catégories de populations et se révéler ainsi contreproductives en ébranlant la cohésion de la nation ».

Des fichiers aux mailles trop larges ?
En 2024, près de 16 000 personnes étaient inscrites au FSPRT, fichier créé en mars 2015 pour rassembler les informations sur les individus suspectés de radicalisation à caractère terroriste. Les mailles de ce fichier sont parfois jugées trop larges, notamment en raison « du flou entourant le concept de radicalisation et de la difficulté à prévoir les passages à l’acte, explique Marc Hecker, directeur exécutif de l’Ifri. L’administration en est consciente et nettoie régulièrement le fichier ». Le FSPRT est distinct du fichier FPR, plus large, des personnes recherchées, dans lequel la mention « S » est attribuée aux terroristes, mais aussi aux hooligans, aux anarchistes ou aux « éco-activistes ».
L’apport des sciences humaines et sociales
Les attentats entraînent une forte pression sur les autorités publiques, en quête de réponses rapides pour protéger les populations. Qu’apporte alors la recherche en sciences humaines et sociales (SHS), dont les travaux s’inscrivent dans la durée ? En empruntant à la sociologie, l’histoire, la science politique, la psychologie, la linguistique, au droit, ces études aident à retracer les événements et clarifier les concepts, parfois au prix de vifs débats, comme ceux portant sur la radicalisation. Quitte à inaugurer de nouvelles manières de procéder.
Créé en 2017 dans l’élan de la mobilisation post-attentats, le Conseil scientifique sur les processus de radicalisation (Cosprad) réunit représentants de l’État, élus (locaux et nationaux) et scientifiques. « Il s’agit de partager les connaissances scientifiques en matière de radicalisation violente pour favoriser l’émergence d’une culture commune, explique Antoine Mégie, politiste (université de Rouen) et coordinateur du Cosprad. Nos travaux nourrissent à la fois l’action publique et la compréhension du grand public ».
Cet organisme a ainsi produit des vidéos grand public et contribué à la formation des personnels de l’éducation nationale lors du procès de l’assassinat du professeur Samuel Paty, assassiné en octobre 2020 à Conflans-Sainte- Honorine. Ses travaux permettent aussi d’interroger l’action d’institutions publiques comme la police ou la gendarmerie, « une démarche essentielle pour permettre à la science de participer concrètement à l’action publique ». Une démarche qui, au-delà des travaux du Cosprad, intéresse l’ensemble des sciences humaines et sociales.
Des contre-pouvoirs institutionnels
En France, plusieurs institutions encadrent l’action du pouvoir exécutif. Par exemple, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a obtenu la mise en oeuvre de phases expérimentales et l’encadrement de nouvelles techniques de renseignement ; le Conseil d’État, la validation par un juge des libertés et de la détention des visites domiciliaires et saisies (ex-perquisitions administratives). De leur côté, « les magistrats s’assurent de la proportionnalité des mesures, souligne l’ancien procureur général François Molins, en cherchant l’équilibre entre deux objectifs apparemment contradictoires : assurer l’ordre public grâce à des moyens supplémentaires et respecter les libertés ».


