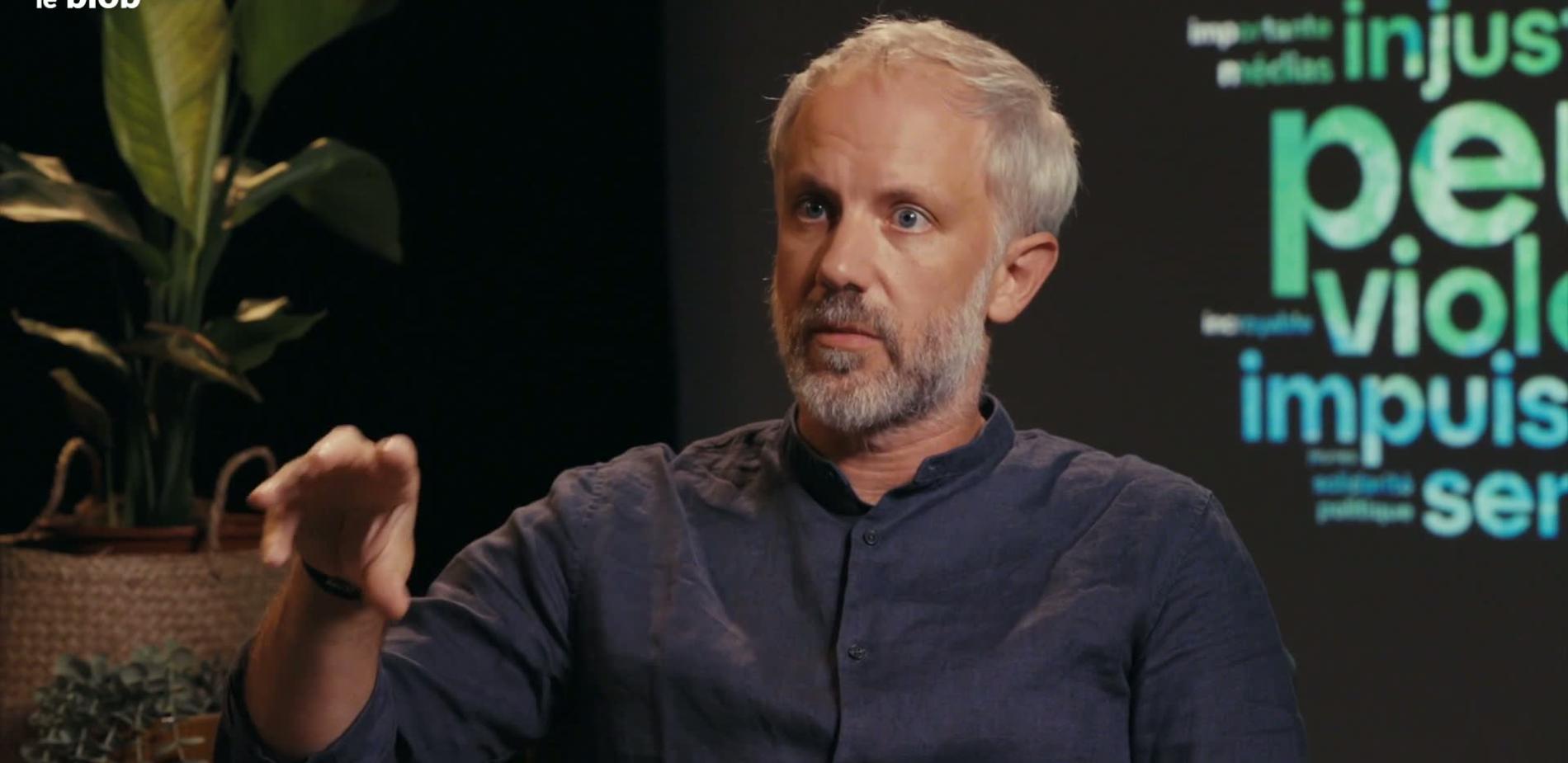
De la stupeur à la résilience : la réaction sociale aux attentats
Après les attentats de 2015, une collecte inédite de messages et d’objets a été menée à Paris pour étudier les réactions sociales face au traumatisme collectif. Les chercheurs ont identifié que, comme après le 11-Septembre, les sociétés suivent des phases de choc, d’unité et d’hystérie avant un retour progressif à la normale, désormais accélérées par les réseaux sociaux. Les explications du sociologue Gérome Truc.
Réalisation : Philippe Baranzani
Production : Universcience
Année de production : 2025
Durée : 12min11
Accessibilité : sous-titres français
De la stupeur à la résilience : la réaction sociale aux attentats
On a plus engagé de recherches et plus collecté de données sur les attentats de 2015 en France, il faut quand même le mesurer, que sur le 11-Septembre aux États-Unis. Ces agglomérations d'objets, de messages, de diverses choses déposées en hommage aux victimes sur les sites d'attentats, ça s'est imposé à nous en France en 2015, parce que ça a été massif aux abords de l'ancien site de "Charlie Hebdo" et puis ensuite, plus encore au moment du 13 novembre, où les différents sites parisiens ont vu des mémoriaux apparaître. Sur le plan scientifique et sur le point de l'étude des réactions aux attaques terroristes et de leur mémorialisation, c'est sans précédent en France et même au-delà. En janvier 2015, la ville de Paris avait été complètement sidérée, sous le choc, et ce qui s'était accumulé face au site de "Charlie Hebdo" n'avait pas été collecté. J'écris à la mairie de Paris, dans les 48 heures suivant le 13 novembre, pour leur dire : "Suite à ce qui s'est passé, vous allez avoir la même chose qu'en janvier, mais en pire. Il va y avoir encore plus de mémoriaux, encore plus de choses accumulées. Il va falloir penser à en faire quelque chose." Or, ce n'est pas la première fois que le problème se pose dans une capitale occidentale. C'est des matériaux que je connais bien, comme les procédures de collecte. Je sais comment on a fait à New York, à Madrid et à Londres. On a fait différemment à chaque fois, ça a pu poser certains problèmes. Donc on peut, fort de ces expériences, réfléchir ensemble à une manière de procéder pour ce qui vient de se passer à Paris. Ainsi s'est mise en place une collaboration avec les Archives de Paris autour de la collecte du contenu de ces mémoriaux apparus sur les différents sites des tueries du 13-Novembre, avec l'idée de commencer par procéder très rapidement à une documentation photographique. Il y a un photographe des Archives de Paris qui a pris en photo tous ces mémoriaux, à la fois des vues d'ensemble mais chaque objet aussi, avec des cadrages plus resserrés. Pièce par pièce, mais sans toucher à rien. Si on retire les choses trop vite, trop tôt, ce qui a pu s'observer, par exemple à New York en 2001, très vite les gens protestent. Et en même temps, si on attend trop, a fortiori quand on est en novembre, quand on est en automne, avec de la pluie, des intempéries, les choses peuvent se dégrader. Il faut trouver le juste équilibre. Du coup, les Archives de Paris ont eu l'idée de procéder à une collecte par vagues. Attendre un délai de décence de quelques semaines, ce qui leur a permis de se préparer aussi. Ils se sont mis à travailler. C'était une belle collaboration unique entre les services de la voirie, les Archives de Paris et des chercheurs. On est sur forcément des milliers de documents, et si on les lit les uns après les autres, c'est très difficile de dégager les schémas récurrents, de ne pas être pris par quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Mon idée, au contraire, c'était d'avoir une démarche qui soit inductive, de prendre la masse des documents et de voir ce qui peut en ressortir, ce qu'on ne peut faire qu'en étant équipés par des logiciels informatiques. C'est comme ça que je me suis rendu compte que ces messages auxquels on ne s'intéressait pas jusqu'à présent, qu'on ne collectait pas, car on les voyait comme des messages de condoléances... Il y a un deuil collectif, les gens sont couchés. Ils expriment qu'ils compatissent au sort des victimes. C'est normal et compréhensible. En les prenant par dizaines de milliers, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça, et qu'il y avait des schémas récurrents quand même. Il y a trois grands types de messages qu'on retrouve dans ces mémoriaux. On a des messages très généraux, très impersonnels et très courts, laissés souvent par des touristes de passage, qui n'ont pas le sentiment qu'ils auraient pu être des victimes. On a ensuite des messages qui sont stricto sensu, des condoléances. Un locuteur s'engage et signe. Ce sont bien souvent des messages laissés au nom d'une famille. Et ce qu'on oublie un peu, c'est un troisième type de messages, ce sont ceux où vraiment les personnes qui écrivent s'identifient directement aux victimes. C'est plus un "Nous sommes avec vous", mais c'est un "Nous" qui englobe tout, où la personne qui écrit le message a le sentiment qu'elle aurait pu être à la place des victimes. C'est ce qui amène des gens, bien souvent, à déposer un billet de concert devant le Bataclan, d'un concert au Bataclan une semaine avant ou qui devait avoir lieu une semaine après. et qui disent : "Ça aurait pu être nous." Quand une attaque terroriste se produit, et qu'il y a un processus social de réaction à l'attentat qui se met en branle, on sait qu'il dure un certain temps, et il passe par différentes phases. Le premier à avoir mis ça en exergue, c'est le sociologue étasunien Randall Collins, après les attentats du 11-Septembre 2001. C'est le premier à montrer que les USA passent par quatre phases. Les quatre phases, pour le dire très brièvement, c'est une première phase de choc. On est sous choc, on cherche à comprendre. Les réactions sont très idiosyncrasiques. C'est un peu le chaos. Randall Collins explique qu'aux États-Unis après le 11-Septembre, ça a duré 24-48 heures. Ensuite, on entre dans une deuxième phase où très vite, une réponse collective s'organise. C'est là où on organise des manifestations, où émergent des mots d'ordre, des symboles pour dire sa solidarité. C'est là où, par exemple, en 2001, en Europe, en France, il y a le mot d'ordre : "Nous sommes tous Américains" qui émerge et : "Nous sommes tous New-Yorkais." C'est dans les jours qui suivent, pas dans les heures qui suivent. Progressivement, une réaction collective s'organise pour venir en aide aux victimes aussi. Les gens vont donner leur sang, etc. Et ensuite, on rentre dans la phase la plus longue, qui est ce que Randall Collins appelle un plateau de solidarité, aussi appelée phase d'hystérie, où l'effervescence sociale fait qu'on est 100 % focalisés sur ce qui vient de se passer. C'est une phase où ne parle que de ça, on essaie de comprendre pourquoi ça s'est produit, ce qu'il faudrait faire pour que ça ne se reproduise pas. On suit beaucoup l'enquête, la traque des terroristes, si traque il y a. C'est une phase qui dure 2 à 3 mois, grosso modo, qui est une phase d'hystérie aussi, parce qu'on est focalisés là-dessus. La société est comme en surrégime, le débat public ne parle de ça. Du coup, c'est très propice à, dans le cas d'attentats islamistes par exemple, à des actes islamophobes, racistes en représailles, mais aussi des périodes qui sont propices à des attaques par imitation de déséquilibrés, de gens qui voient ce qui s'est passé à la télévision et qui se disent qu'ils vont faire pareil, ce que les psychologues appellent les copycats. C'est des phases qui sont aussi propices à des mouvements de panique infondés. Par exemple, après les attentats du 14 juillet 2016 à Nice. Dans les semaines, mois qui suivent, il y a des mouvements de panique. Pendant l'été, à Antibes, à Juan-les-Pins, il suffit d'entendre un bruit, un pétard, et on pense que c'est une nouvelle attaque terroriste. C'est propre à cette période-là où la société, comme en surrégime, est très focalisée sur ce qui s'est passé. Et puis ensuite, progressivement, ça redescend, on revient à la normale. C'est la quatrième phase, où on en parle de moins en moins. On se met à parler d'autres choses. Si on enchaîne les différentes périodes, on arrive à un total de 8-9 mois. Ce qui était tout à fait inédit en 2015 et 2016, c'est qu'en janvier 2015, on vit l'attaque de "Charlie Hebdo", de Montrouge et l'Hyper Cacher. On vit ça comme un 11-Septembre français, c'est la une du "Monde". Et au moment où on sort de ce processus, où on commence à revenir à la normale en France, on a les attaques du 13 novembre. Donc on replonge dans ce processus, de plus belle, je dirais. Et puis pareil, passé le 13-Novembre, 8-9 mois après, on arrive à l'été 2016, c'est la période de l'Euro, on commence à parler d'autre chose, on parle de lever l'état d'urgence, et puis, à nouveau, attentat du 14 juillet à Nice, un camion bélier, un attentat de masse à nouveau, plusieurs dizaines de morts. À chaque fois, on a retrouvé ce même processus. Avec mes collègues en 2015, l'un des enjeux aussi de la recherche était de vérifier dans quelle mesure on retrouvait ou pas ces quatre phases 15 ans après, et si les réseaux sociaux changeaient quelque chose ou pas à celles-ci. La réponse est qu'ils ne changent rien, si ce n'est qu'il y a un phénomène d'accélération. Très clairement, le slogan "Je suis Charlie" en janvier 2015, il émerge sur Twitter quelques heures après l'attentat, après l'attentat contre la rédaction de "Charlie Hebdo". Donc en 2001, "Nous sommes tous Américains, nous sommes tous New-Yorkais", ça émerge dans les 24-48 heures. C'est notamment le titre d'un éditorial du "Monde". En 2001, il n'y a pas les réseaux sociaux, ça en passe par la presse, par les médias de masse qui contribuent à mettre en forme les réactions collectives et de manière très significative, en 2015, quand "Libération" titre "Nous Sommes tous Charlie", c'est déjà trop tard, il reprend un slogan qui s'est déjà imposé et déjà devenu complètement viral : "Je suis Charlie." Une question qu'on pose souvent dans ces moments-là, c'est "Qu'est-ce que ça produit, l'attentat ? Ça nous rend plus solidaires ou ça nous divise davantage ?" La réponse des chercheurs en sciences sociales, c'est que c'est les deux à la fois et que les deux sont comme les deux faces d'un même processus ou d'une même pièce. Ça nous rend à la fois plus solidaires, il y a une réaction de cohésion sociale. Quand on est attaqués, on fait front. C'est assez automatique. Et donc oui, après l'attaque de "Charlie Hebdo", il y a la marche du 11 janvier. Spontanément, les gens descendent dans la rue oublient leurs différences et leurs divergences et considèrent que le plus important dans ces circonstances-là, c'est d'être unis face au terrorisme. Il y a des scènes d'embrassades avec les policiers, etc. C'est dans ce contexte-là que "Je suis Charlie" devient viral. On va dans la rue, on dépose des choses en hommage aux victimes, on dit qu'on est Charlie. Et ça alimente ces débats qui, exactement en même temps, exacerbent les divisions. Où les gens disent : "Oui, je suis Charlie", mais quand ils discutent, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas Charlie pour les mêmes raisons. Ça nous a déchirés en France, et on en parle encore dix ans après. Sociologiquement c'est quelque chose de très normal et de très documenté. L'Espagne a vécu la même chose en 2004. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, la même chose en 2005 après les attentats de Londres. Les États-Unis après le 11-Septembre. C'est systématique, c'est un même processus social. Les réseaux sociaux n'y ont rien changé à part accélérer les premières phases. Et la recherche en sciences sociales est à mon sens ici, très précieuse pour objectiver ce qui nous arrive dans ces circonstances, car le risque est d'être complètement agi par ce processus social. Si on est conscients qu'on traverse une zone d'effervescence sociale, qui est ponctuelle et dangereuse parce qu'elle confine un peu à l'hystérie, pour reprendre le terme de Randall Collins, si on en est conscients de ça, on peut imaginer que ça nous amène à être un peu plus prudents. À ne pas tomber dans certains faux débats, à tenir compte du fait qu'on est dans un contexte particulier et qu'il faut essayer de tempérer pour éviter d'envenimer les choses. Force est de constater, malheureusement en 2015, qu'il y a eu nombre de réactions, à la fois de médias, de journalistes et de politiciens, qui ont au contraire contribué à alimenter l'hystérie, à creuser le clivage et donc à aller complètement à l'encontre de la prudence dont on pourrait espérer qu'elle puisse être nourrie par une meilleure compréhension de ce qu'on traverse dans ces moments-là quand on est en proie à une attaque terroriste.
Réalisation : Philippe Baranzani
Production : Universcience
Année de production : 2025
Durée : 12min11
Accessibilité : sous-titres français

