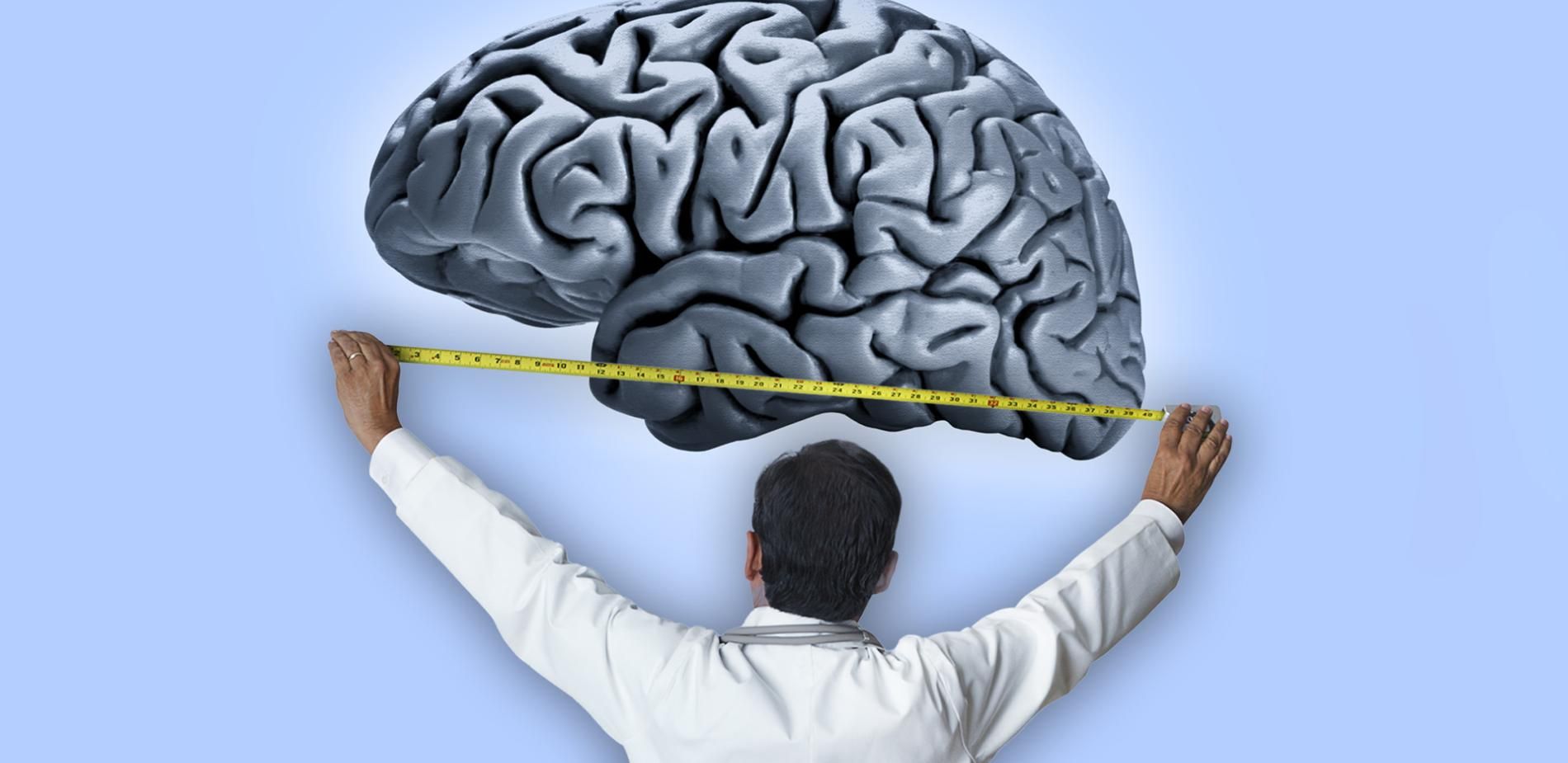
Mesurer l’intelligence humaine
Le QI mesure l’intelligence générale à travers diverses capacités cognitives, influencées à la fois par les gènes et l’environnement. Mais cette mesure reste incomplète : elle ignore par exemple la créativité ou l’intelligence sociale. Explications de Franck Ramus, chercheur en sciences cognitives et directeur de recherche au CNRS.
Réalisation : Mélissande Bry
Production : Universcience
Année de production : 2025
Durée : 12min41
Accessibilité : sous-titres français
Mesurer l’intelligence humaine
Si vous demandez à 200 personnes leur propre définition de l'intelligence humaine, vous aurez droit à 200 réponses différentes. Car l'intelligence est une notion intuitive, un mot du langage courant. Pourtant, au même titre que le poids, la taille ou la température, l'intelligence a une définition scientifique précise et il existe des outils pour la mesurer : les fameux tests de quotient intellectuel. Résultat d'un siècle d'études avec des pionniers comme Alfred Binet en France ou Charles Spearman en Angleterre, ces tests évaluent tout un tas de fonctions cognitives et sont la mesure la plus fiable de ce que les psychologues appellent l'intelligence générale. Mais finalement, que signifie vraiment ce score de QI ? De quoi est-ce qu'il dépend ? Est-ce qu'il est vraiment utile de le connaître et surtout comment aller au-delà? En psychologie, avant même de parler de QI, l'intelligence est d'abord définie par une lettre : le facteur G. Quand on fait passer plusieurs tests à des gens, en général, les scores dans ces tests sont tous corrélés. C'est-à-dire que les gens qui ont des bons scores à un test vont en moyenne avoir des bons scores aussi aux autres tests. Et du coup, cette observation donne l'impression qu'il y a un facteur commun dans la performance à tous les tests cognitifs. Et le facteur G, ça désigne ce facteur commun et on a des procédures statistiques qui permettent de le calculer à partir des scores obtenus dans tout un tas de tests. On va appeler ça l'intelligence générale. Le facteur G est une valeur brute qui, seule, ne veut pas dire grand-chose. Pour comparer les performances entre individus, le facteur G est quantifié sur une échelle particulière. C'est le fameux score de QI qui, lui, est un score standardisé, relatif à une population et dans une classe d'âge donnée. Par définition, on va dire que la moyenne de cette classe d'âge, c'est 100, et l'écart type, c'est-à-dire l'épaisseur de cette distribution, c'est 15. Ce qui fait qu'il va y avoir à peu près deux tiers des gens qui sont entre 85 et 115, et puis 2 % des gens qui sont au delà de 130 et 2 % des gens qui sont en dessous de 70. Les tests de QI les plus utilisés dans le monde sont les batteries de Wechsler, qui existent en différentes éditions. Le WAIS pour les adultes, le WISC pour les enfants et le WPPSI pour les tout-petits, en dessous de 6 ans. Dispensés par des psychologues agréés, ces tests permettent d'évaluer les performances d'un individu dans quatre grandes dimensions cognitives. Dans toutes les batteries de tests, il va y avoir des tests verbaux et des tests non verbaux. Les tests verbaux sont, par exemple, des tests de vocabulaire ou des tests de culture générale aussi. Il va y en avoir qui vont tester les compétences visio-spatiales, comme par exemple, le test des cubes où il faut... On a un petit dessin et il va falloir essayer de le reproduire avec les cubes-là. Il y en a d'autres qui sont plutôt comme les tests des matrices ou des puzzles visuels où il faut trouver l'image manquante dans une série. Donc il faut essayer de retrouver la règle, en fait, qui détermine l'arrangement des figures ici. Puis il va y avoir aussi des tests de mémoire, où il va falloir retenir un certain nombre d'éléments, soit sur une courte durée, soit sur une durée plus longue. Il va y avoir des tests de rapidité, où il faut par exemple faire une recherche visuelle sur une page de symboles et cocher certains d'entre eux le plus vite possible. L'intérêt principal, en général, est d'avoir tout le profil cognitif de la personne, c'est-à-dire le détail de ses performances dans chacun des tests et dans chacune des grandes dimensions cognitives. Et ça, en général, c'est utilisé par les psychologues dans un cadre clinique, c'est-à-dire quand il y a une interrogation sur des difficultés de la personne. Quand la personne a soit des troubles cognitifs, soit des troubles psychologiques, souvent, on est amené à faire passer la batterie de tests de QI, justement pour avoir une évaluation de son niveau cognitif, de ses forces et de ses faiblesses, et pour interpréter aussi ses symptômes cliniques. Après, pour les gens dans la vie de tous les jours, peut-être qu'on en parle trop des scores de QI parce qu'en vérité, ils n'ont pas tellement d'application pratique et connaître son score n'apporte pas grand-chose. Il n'y a aucune raison d'essayer de mesurer les scores de tout le monde, enfin... Franck Ramus est directeur de recherche au CNRS. Spécialisé en sciences cognitives, lui et son équipe s'intéressent aux différences individuelles dans le développement cognitif et dans les apprentissages scolaires. Leurs dernières recherches se penchent, entre autres, sur l'influence de la génétique et de l'environnement sur la cognition humaine et utilisent des données issues de cohortes, un outil de recherche particulièrement important. Les cohortes ELFE et cohortes EDEN, ce sont des cohortes de naissance, où ils ont recruté un certain nombre de femmes enceintes dans des maternités pour les inclure dans un protocole de recherche dans lequel on a suivi leurs enfants depuis la gestation jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Dans la cohorte qu'on utilise le plus actuellement, qui est la cohorte ELFE, ils ont recruté, en 2011, 19 000 nouveau-nés. Et donc ce qui est intéressant dans ces cohortes, c'est qu'on prend toutes les mesures possibles et imaginables sur ces enfants et sur leur environnement. C'est une cohorte qui est prévue pour poser une multitude de questions sur tous les aspects de la vie finalement, sur évidemment tous les facteurs qui peuvent engendrer des maladies, mais qui peuvent aussi affecter le développement de toutes les manières. Dans ces facteurs, il y a bien sûr le bagage génétique transmis des parents aux enfants. Au départ estimé via des études familiales, l'arrivée de nouveaux outils en génomique au début des années 2000 permet une analyse plus fine de l'héritabilité de l'intelligence. Il y a plus de mille gènes qui sont connus dont des mutations ont un impact important sur les compétences intellectuelles. Donc la part génétique, qu'on appelle l'héritabilité, ça dépend un petit peu comment on la mesure. On est entre une fourchette basse et une fourchette haute. On sait que les études génomiques sous-estiment en partie les effets génétiques et on a des raisons de penser aussi que peut-être les études de jumeaux les surestiment. Et donc voilà, on va dire, dans cette fourchette entre 20 et 50 %, la vérité est quelque part. À chaque fois qu'on évoque la génétique en lien avec l'intelligence, il y a plein de personnes qui sont très contrariées parce qu'elles pensent que forcément, ça doit conduire à l'eugénisme ou à n'importe quelle autre mauvaise utilisation des données génétiques. Mais je dirais, ça, c'est un peu le lot de toute connaissance scientifique. Tout ce qu'on apprend peut être bien utilisé ou mal utilisé. D'ailleurs, on a déjà des lois de bioéthique qui nous interdisent d'utiliser l'information génétique pour certaines discriminations, par exemple. Donc, ce n'est pas comme si on découvrait le problème et qu'on ne s'était pas déjà un petit peu prémunis contre ça. En plus des gènes, beaucoup de facteurs environnementaux ont un impact significatif sur l'intelligence. Mais lesquels sont les plus importants ? En premier lieu, la nutrition. Il faut que le fœtus soit bien nourri déjà in utero. Et puis, le bébé et l'enfant doivent être bien nourris parce que son cerveau, c'est un gros consommateur d'énergie. Il faut que sa santé soit bonne. Il y a quand même pas mal de maladies qui peuvent affecter le développement du cerveau dès la gestation, notamment des infections contractées par la mère ou aussi l'exposition à des toxiques de la mère enceinte. Et puis bien sûr, l'autre grande composante, c'est l'éducation. L'éducation, à la fois, qu'on peut recevoir au sein de la famille, et notamment tout le langage qu'on va entendre et qui va permettre à chaque enfant d'acquérir lui-même le langage. Donc tout le vocabulaire qu'il va acquérir, etc. Et puis aussi, l'environnement extra-familial, ce qui se passe en dehors, et évidemment en particulier ce qui ce passe à l'école. Puisque l'école, c'est quand même le lieu où les enfants apprennent le plus sur leurs vingt premières années. On estime que chaque année de scolarité augmente l'intelligence des enfants de l'équivalent de trois points de QI. Quand on compare les scores de QI totaux, on ne voit pas de différences notables entre les hommes et les femmes. En revanche, certaines fonctions cognitives semblent avoir une dimension genrée. Ces disparités se remarquent surtout dans les premières années de la vie, et tout particulièrement dans le cadre scolaire. Parmi les différences qu'on observe le plus entre les garçons et les filles au cours du développement, il y en a une qui s'observe très tôt. C'est le fait que les filles sont en avance sur le langage par rapport aux garçons. Elles prononcent leurs premiers mots plus tôt, elles ont plus de vocabulaire, etc. Les filles vont être meilleures en lecture, en orthographe et elles le resteront toujours, en moyenne. C'est des différences en moyenne, bien entendu. Et puis après, une fois que les enfants rentrent à l'école, à partir du CP, il va y avoir une autre différence qui va émerger, qui est en mathématiques. Là, dès le milieu du CP, finalement, les garçons vont prendre un petit peu d'avance. Donc après, tout le problème, c'est de savoir pourquoi il y a de telles différences entre garçons et filles. Et pour aller directement à la conclusion : on n'a pas la réponse définitive. Donc il peut y avoir des différences cognitives entre les sexes qui ont vraiment une origine biologique précoce. C'est pas impossible. Mais à démontrer, c'est très compliqué. Et puis évidemment, il y a toute une autre catégorie d'hypothèses qui sont dans l'environnement. On sait très bien qu'on n'élève pas les garçons et les filles de la même manière. Quasiment depuis la naissance, ils vivent dans des environnements légèrement différents qui peuvent induire le développement de capacités légèrement différentes. Par exemple, on va plus souvent engager les garçons dans des activités physiques que les filles. On va plus, souvent leur donner des jeux de construction, des jeux de balles. À côté de ça, peut-être qu'on sollicite plus les compétences sociales des filles. On va leur donner des poupées, des personnages. Elles vont plus jouer à des jeux de rôles, etc. C'est une chose de constater qu'il y a des différences dans l'environnement des garçons et des filles. Ça, c'est incontestable. Mais c'en est une autre, de prouver que ces différences dans leur environnement causent les différences cognitives qu'on observe ensuite. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, en vérité, et il n'y a pas tellement de démonstration de ça dans les recherches scientifiques. Les compétences cognitives évaluées dans les tests de QI dépendent de différentes structures cérébrales et neuronales. Ainsi, est-ce qu'on peut mesurer l'intelligence uniquement en observant le cerveau? Aujourd'hui, on peut faire autant d'IRM qu'on veut, on n'arrivera pas à vraiment bien estimer l'intelligence de la personne. Il vaut mieux passer un test. C'est beaucoup plus fiable. Mais on connaît quand même des corrélats cérébraux de l'intelligence. Donc, le premier d'entre eux, c'est simplement la taille du cerveau. Le volume cérébral est corrélé au score de QI à hauteur d'environ 0,3. C'est pas non plus qu'avoir une grosse tête, ça vous rend forcément intelligent. Mais bon, il y a une petite corrélation. Et puis après, si on regarde dans le détail, c'est plutôt les volumes de matière grise que les volumes de matière blanche, plutôt dans les lobes frontaux, qui contiennent les fonctions exécutives, que dans d'autres lobes qui contiennent des fonctions plus périphériques. Et puis il semble que la connectivité aussi entre les deux hémisphères cérébraux soit corrélée avec les scores d'intelligence. Si les tests de QI sont aujourd'hui la mesure la plus fiable de l'intelligence générale, ils présentent aussi, indéniablement, de réelles limites. Je pense qu'un bon projet de recherche, ce serait d'améliorer les mesures de l'intelligence sociale typiquement. Parce que ça, pour moi, c'est la plus grosse lacune dans les batteries de tests actuelles, principalement parce qu'on n'a pas des bons outils de mesure des compétences sociales. On a des questionnaires dans lesquels les gens répondent : comment ils réagissent dans tel type de situation. Mais bon, c'est auto-déclaré. Il y a une fiabilité moyenne. Et puis, on a des tests de certaines compétences sociales, comme, par exemple, la capacité à distinguer différentes expressions émotionnelles sur les visages. Mais du coup, ça devient des compétences sociales extrêmement restreintes qui capturent pas du tout l'ensemble de ce qu'on aurait envie de mesurer. Et puis, il y a d'autres choses qui ne sont pas testées dans les batteries de tests de QI, comme la créativité, par exemple, ou le sens de l'humour, ou l'honnêteté. Enfin voilà, il y a plein de qualités qu'un être humain peut avoir qui ne sont pas juste des capacités cognitives mesurées dans les tests.
Réalisation : Mélissande Bry
Production : Universcience
Année de production : 2025
Durée : 12min41
Accessibilité : sous-titres français

